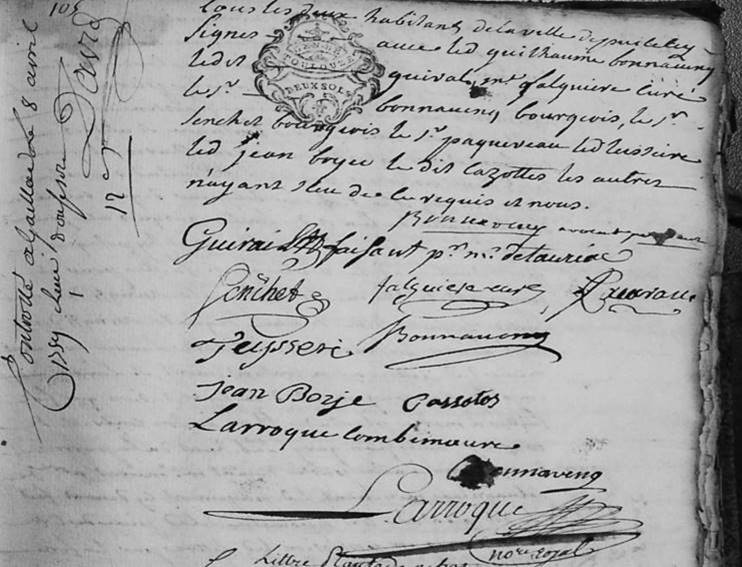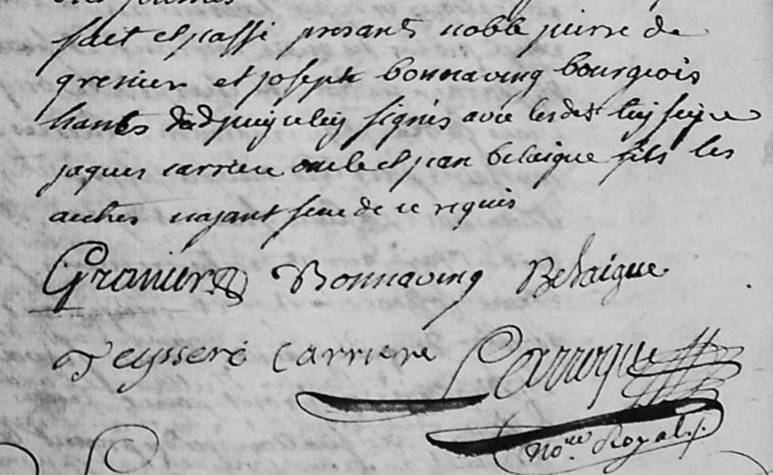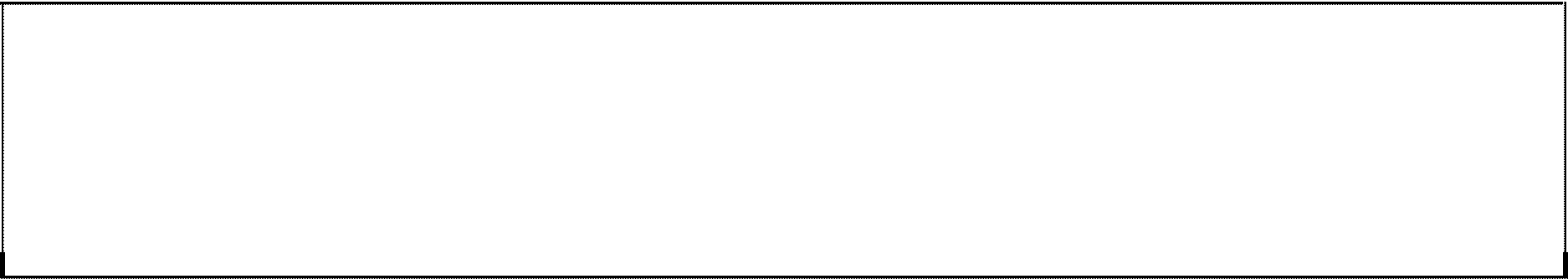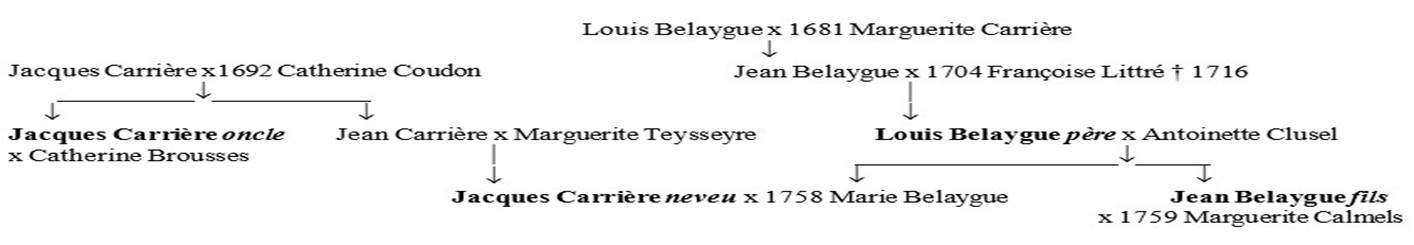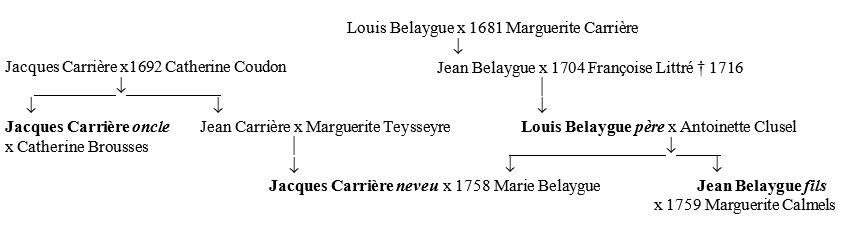La reconstruction de l’église St Nazaire de Larroque en 1759
par
Yves Cambefort
Résumé. L’actuelle église St Nazaire
de Larroque (Tarn)
a été construite en 1759 au milieu du village, en remplacement de l’église paroissiale antérieure, qui était
située hors de celui-ci. Les paroissiens de 1759 ont financé en partie cette construction. On présente ici deux actes notariés de 1759. Le premier rend compte d’une assemblée de paroissiens qui ont décidé cette construction et proposé de la financer.
Une annexe récapitule les contributions offertes par chacun d’eux. Le second acte détaille les prescriptions données
aux entrepreneurs choisis pour effectuer
ce travail. On présente enfin une petite prosopographie de toutes les personnes mentionnées dans ces textes
: paroissiens, entrepreneurs, notaire, témoins, experts.
Les relations de parenté mises en évidence
entre tous ces intervenants permettent d’entrevoir le fonctionnement de cette communauté
villageoise, ainsi que ses rapports avec le consulat de Puycelsi, dont elle dépendait.
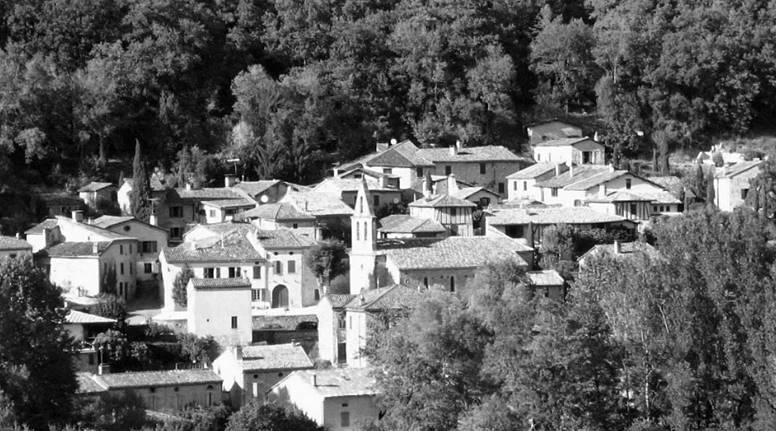
Le
village de Larroque (Tarn) tel qu’il est actuellement, avec en son centre l’église St Nazaire de 1759.
(document internet, d’après le site officiel de la commune de Larroque)
1. Introduction
Monsieur Stéphane Grégoire, généalogiste bien connu dans le Tarn, a
bien voulu me communiquer deux actes notariés,
conservés aux Archives
départementales du Tarn, qui concernent la reconstruction en 1759 de l’église Saint
Nazaire, dans la paroisse
du même nom.
Jusqu’à 1791, cette paroisse faisait
partie de la communauté de Puycelsi1. Elle correspond à un village
qui porte depuis le moyen âge le nom conservé
jusqu’à nos jours : Larroque,
1 Le Pottier, 1990, pp. 222-223 et 373-375.
probablement dû
à la falaise de calcaire ocre qui surplombe le village et que les habitants désignent encore de nos jours en disant « le
Rocher » ou « le Roc ».2 Outre
le village, ou Larroque proprement
dit, la commune comprend aussi la paroisse St Martin d’Urbens,
avec l’ancienne paroisse Notre-Dame du Désert de Mespel et le hameau des
Abriols.
La paroisse
Saint Nazaire avait sans doute, au XVIIIe siècle,
la configuration qu’elle
a conservée de nos jours : le village de Larroque,
formé de quelque soixante maisons blotties dans les bois, au pied de la falaise,
plus un certain
nombre de fermes ou résidences éparses aux environs, dans la vallée
de la rivière Vère, affluent de l’Aveyron. Jusqu’en
1759, le village
n’avait pas d’église,
et le centre spirituel de la paroisse,
formé par l’église
et le cimetière, était situé à 600 m au sud- est, tout près de la Vère,
à l’emplacement du cimetière actuel. En 1753, comme l’indique le premier
des deux textes
édités ici, l’ancienne église menaçait ruine, et l’archevêque d’Albi, lors de sa visite du 23 mai, avait
ordonné qu’elle soit démolie et reconstruite dans le village,
au plus près de la majorité des paroissiens. Peu avant 1759,
l’assemblée des consuls de Puycelsi s’était émue à nouveau de la dégradation de l’église
et avait proposé de la restaurer. Le coût de cette restauration était estimé à 400 livres, que les consuls se
proposaient de financer, comme ils le faisaient pour leur autres dépenses d’investissement, sur les impôts de la communauté (essentiellement la taille). Mais la solution qu’ils prévoyaient
était peu satisfaisante, comme l’explique
toujours ce premier texte, et ne respectait pas les prescriptions de
l’archevêque : ils proposaient de
restaurer l’ancienne nef à son emplacement originel, et de bâtir un nouveau chœur et une nouvelle sacristie dans le village
de Larroque. Cette
solution bizarre aurait
eu pour résultat de diviser l’église en deux parties, distantes de 600
m. C’est alors que Raymond Senchet, consul « moderne », qui représentait Larroque au
sein de l’assemblée consulaire de Puycelsi, décida
de prendre en main la situation. Il alerta d’autres
notables du village,
et ce petit noyau convoqua
une assemblée de paroissiens pour une
délibération devant notaire, afin d’examiner
ces deux projets, celui de l’archevêque et celui des consuls. On devine que la préférence des villageois allait au projet
de l’archevêque ; mais comme celui-ci nécessitait une mise de fonds plus considérable que les 400 livres prévues
par les consuls,
il fallait aussi qu’un certain nombre de paroissiens acceptent
de participer au financement du supplément à verser aux entrepreneurs. Les étapes intermédiaires n’ont laissé aucune
trace, mais le premier acte nous livre
le compte rendu de l’assemblée du 28 mars 1759, qui prit comme on le verra la décision
de suivre l’ordonnance de l’archevêque et de bâtir une nouvelle église dans le village. Le
coût total de ce projet étant évalué à 1500 livres par les entrepreneurs, il
s’agissait donc de réunir les 1100
livres supplémentaires pour rebâtir l’église, ou plutôt la construire
entièrement à neuf, au
centre du village, où nous la voyons encore de nos jours.
On ignore
entièrement les discussions et tractations préliminaires, mais le compte
rendu notarié de l’assemblée du 28 mars 1759 montre
qu’elles se révélèrent fructueuses, car la somme de 1100 livres fut très exactement réunie par les contributions des
41 paroissiens présents ou représentés.
Ce nombre de 41 doit être rapporté à la population du village à ce moment, qui nous est inconnue mais qu’on peut estimer
à l’aide des chiffres donnés un siècle plus tard par le Dictionnaire historique et géographique du département du Tarn, d’Auguste
Tranier (1862). Celui-ci
indique, pour le village de Larroque, une population de 242 habitants
pour 64 maisons. On voit qu’il
y avait entre trois et quatre occupants par maison. Ce chiffre, qui ne devait
pas être très différent en 1759,
correspondait à un couple avec un ou deux enfants, ou un enfant et un aïeul. On voit que les maisons
abritaient des familles restreintes, les grands parents résidant souvent dans leur propre maison, qui du
reste était rarement éloignée. Les 41 paroissiens rassemblés le 28 mars 1759 représentaient à peu près les 2/3 des maisons,
et donc la majorité
2 La falaise de Larroque serait
d’âge oligocène : cf. document
ASNAT à l’adresse https://asnat.fr/Dossier% 20
geologie/vertebres castrais/vertebres-tarn-lithostratigraphie.php
du village.
Venaient s’y ajouter des contributeurs que l’on pourrait qualifier d’« honoraires » : le seigneur
du village, le curé de Puycelsi,
dont St Nazaire était une annexe3, et divers notables
de Puycelsi qui pensaient, à un titre ou à un autre, être concernés par ce
projet.
Je reproduis ci-dessous les deux actes concernant cette reconstruction. Ils font partie
du registre d’Antoine Joseph Larroque, notaire
à Puycelsi, conservé
aux Archives départementales du Tarn sous la cote 3E7/4064. Le premier texte rend compte
de l’assemblée du 28 mars 1759
; le
second est un « traité
», consistant de fait en prescriptions détaillées données aux entrepreneurs pour la construction du futur bâtiment. Il est à
croire, vu leur caractère technique, qu’elles ont été rédigées d’après les indications des entrepreneurs eux-mêmes, avec l’approbation des contrôleurs
mandatés par les paroissiens. Suit une courte prosopographie de tous les
acteurs mentionnés dans ces textes.
On y verra que la plupart sont apparentés, entre eux et avec les entrepreneurs, ce qui n’est guère étonnant
vu le faible nombre d’habitants de ces villages, où l’endogamie était forte.

La façade de l’église St Nazaire
de Larroque, état actuel.
(photographie de Sébastien
Colpin à l’adresse
https://image.over-blog.com/MHBBfNY4pSv-
_GaanWbm8BtcW54=/filters:no_upscale()/image%2F1835109%2F20220723%2Fob_efb6e6_23062022-dsc7916-copier.jpg, modifiée).
On
observe que la façade est décentrée par rapport à l’axe longitudinal de
l’édifice, pour tenir compte de la
déclivité du terrain et de la situation de l’édifice à l’extrémité de la place principale du village.
3 Voir «
État des Églises principales, Annexes,
Dépendances, Monastères, Prieurés, & Chapelles votives
du Diocèse d’Alby », dans Choiseul, 1763 (p. 230).
4 Ce registre a été mis en ligne par les Archives
Départementales du Tarn à l’adresse
https://e-archives.tarn.fr
/viewer/series/LECTEURSImages/ImagesLecteur_3E7-406 d’après des clichés pris par
Stéphane Grégoire.
2. Actes notariés
2.1. Délibération
des paroissiens de Larroque le 28 mars 1759.
Source : Archives départementales du Tarn, Minutes de Me Antoine
Joseph Larroque, notaire à Puycelsi, cote 3E7/406, pp. 97-105. Le texte a été
divisé en alinéas et l’orthographe normalisée.
« L’an mil sept
cens cinquante neuf et le vingt-huitième
jour du mois de mars. Pardevant nous notaire royal de la ville de Puycelsi
soussigné, et présents les témoins bas nommés au lieu de Larroque et dans le local où la paroisse dudit Larroque a
accoutumé de s’assembler. Ont été assemblés
: maître Guillaume Bonnavenq avocat en Parlement
habitant dudit Puycelsi, et appelé
pour présider à la présente assemblée, le sieur Géraud Guiral
bourgeois habitant de Saint-Urcisse
faisant pour et au nom de messire Louis Joseph Eugène de Boyer de Castanet chevalier marquis de Tauriac, seigneur du
présent lieu, Roquemaure, Castanet et autres places, lieutenant du roi de la province de Rouergue et capitaine dans le régiment
des cuirassiers, maître
Guillaume Falguière curé dudit Puycelsi, Raymond Senchet consul moderne du présent lieu de Larroque, sieur Jean Bonnavenq bourgeois
habitant dudit Puycelsi,
sieur Jean Senchet bourgeois, sieur Bernard Paquereau, brigadier des gabelles au poste du présent lieu,
Bernard Cazottes,
Jean Cazottes jeune, Joseph Senchet,
Guillaume Teisseyre, Jean Teisseyre,
Jean Cazottes
dit Jean d’Antoine, Bernard Négrier, Jean Cazottes
dit Laroche, Marie Suech veuve de Pierre Arman, Jacques Rech [et] Jean Loubet beau-père et
gendre, Pierre Calmels, Pierre Gay, Jean Gay, Jean Arman
dit Jantou, Philippe
Roux, Antoine Carrié
dit Taujou, Jean Druilhe, Jean Carrat,
Jean Arman, Jean Rossignol, Jean Boyer faisant
tant pour lui que pour ses neveux,
Antoine Gasc, Antoine Charrat, Paul Mary, Jean
Bonnencontre, Pierre Bonnencontre gendre d’Audourenq, Jean Rech, Pierre Rech, Antoine Carrié dit La Mazoque, Jean Bazanes, Bernard Rech dit Mafrounet, Jacques
Gardes, Bernard Borios, Pierre Biau, tous paroissiens et habitants du présent lieu de Larroque.
« Auxquels
ledit Senchet consul a dit que la communauté de
Puycelsi, de laquelle la présente paroisse
est taillable, au préjudice des dispositions de l’ordonnance rendue en cours de
visite par Mgr l’archevêque d’Albi le
vingt-trois mai mil sept cent cinquante trois qui a
ordonné que l’église dudit Larroque
sera démolie et transférée dans le présent village, allait faire réparer la vieille église en suivant les dispositions
d’une ordonnance de feu monsieur Le Nain jadis
intendant de cette province, qui avait permis de faire procéder au devis estimatif des réparations à faire à la vieille nef et de recevoir
des moins dites, que la dernière moins dite étant faite pour quatre cents livres, les consuls dudit
Puycelsi allaient demander la permission de passer le bail et d’emprunter ladite somme en la forme
ordinaire pour servir au payement de l’entrepreneur et faire par ce moyen réparer ladite vieille nef. Ledit consul a
ajouté qu’il est important pour la paroisse
de Larroque que ladite ordonnance de Mgr l’archevêque ait son exécution par les raisons ramenées dans ladite ordonnance de
laquelle il a fait la lecture, et a ajouté qu’il était absolument inévitable de concourir à l’exécution de ladite ordonnance dudit seigneur archevêque puisque par contrat du trois
janvier dernier [1759] retenu par maître Bousquet notaire de Villeneuve d’Albigeois, messieurs les gros
décimateurs, et fruits prenants de la présente
paroisse ont baillé le chœur et sacristie à rebâtir et construire à neuf dans
le présent village sur le local qui
serait choisi par les habitants d’icelui, et a fait encore ledit consul la lecture
dudit bail de nouvelle construction, et a dit que le nommé Joseph
Senchet, et Jean Carrat habitants du présent village
et ici présents offraient de délaisser gratis le terrain
nécessaire pour construire tant ledit chœur et sacristie que ladite nef au bout des possessions qu’ils ont attenantes et contiguës au présent village et qu’ainsi la chose devient
aujourd’hui autant inévitable qu’elle est importante et utile au bien de la paroisse,
puisque le chœur et sacristie
vont être
rebâtis dans le village tandis que ladite nef resterait où elle est éloignée
dudit village sans avoir de chœur ni
sacristie, ajoutant ledit consul que si la communauté de Puycelsi qui prétend n’être obligée que de réparer la
vieille nef voulait sous le bon plaisir de monseigneur l’Intendant, et de MM. les commissaires du roi imposer les
quatre cents livres qui font le montant
des réparations à faire à la vieille
nef pour être payées à l’entrepreneur qui serait chargé
de la construction de la nouvelle nef, les entrepreneurs qui sont
chargés de la construction du nouveau chœur et sacristie, ayant su les proclamations qui ont été faites, offrant
de rebâtir ladite
nef et clocher pour une somme de quinze cents livres en employant les
matériaux de la vieille nef qui seraient de service, et que lesdits
entrepreneurs étaient ceux qui avaient
fait la condition meilleure, et ledit consul a dit qu’il ne manquerait en ce cas qu’une somme de onze cents livres,
et que les paroissiens ici assemblés pourraient volontairement former
entre eux ladite somme de onze cents livres,
et s’obliger de la payer à l’entrepreneur de la nouvelle
nef, ou à celui qu’on nommerait pour la
recevoir.
« Sur quoi lesdits assemblés
ont délibéré d’une voix unanime
qu’il convenait de faire des efforts redoublés pour un objet si intéressant
pour la paroisse en général et ledit Géraud Guiral
faisant pour monsieur le marquis de
Tauriac seigneur du présent lieu a promis de compter à qui sera nommé à cet effet une somme de trois cents
livres. Ledit maître Guillaume Falguière curé de Puycelsi pour zèle pour la maison de Dieu a promis de remettre
également à qui sera nommé à cet
effet une somme de cent cinquante livres. Le sieur Jean Bonnavenq
a promis également la somme de
cinquante-cinq livres. Ledit Senchet bourgeois dudit
Larroque a promis également la somme de soixante-cinq livres. Ledit Raymond Senchet consul a
promis aussi de remettre
la somme de trente livres,
ledit sieur Paquereau celle
de quinze livres,
ledit Bernard Cazottes celle
de trente livres,
Jean Cazottes jeune celle de quinze livres,
Joseph Senchet celle
de vingt-quatre livres, Guillaume Teisseyre
celle de trente-six livres, ledit Jean Teisseyre
celle de dix-huit livres, Jean Cazottes dit Jean d’Antoine celle de quinze livres, ledit
Bernard Négrier celle de neuf livres,
ledit Jean Cazottes dit Laroche celle de dix livres,
ladite Marie Suech celle de trois livres,
Jacques Rech et Jean Loubet beau-père et gendre celle de dix livres, Pierre
Calmels celle de trente-six livres, ledit Pierre Gay celle de quinze livres,
ledit Jean Gay aîné celle de dix livres, ledit Jean Arman dit Jantou
celle de vingt livres, ledit Philippe Roux celle de trois livres, ledit Antoine Carrié celle de trente livres,
ledit Jean Druilhe celle de douze livres, ledit Jean
Carrat celle de vingt-quatre livres,
ledit Jean Arman dit Jean Danne celle de douze
livres, ledit Jean Rossignol celle de trois
livres, ledit Jean Boyer tant pour lui que pour ses neveux
celle de vingt-
quatre livres, ledit
Antoine Gasc celle
de treize livres,
ledit Antoine Charrat
celle de trois livres, ledit Paul Mary celle de trois livres,
ledit Jean Bonnencontre celle de dix livres, ledit Pierre Bonnencontre gendre dudit Audourenq celle de dix livres, ledit Jean Rech celle de quinze livres,
ledit Pierre Rech arçonnier celle de douze
livres, ledit Antoine Carrié dit La Mazoque celle de trois livres, ledit Jean Bazanès celle de douze livres, ledit Bernard Rech dit Mafrounet celle de dix
livres, ledit Jacques Gardes celle de quinze livres, ledit Bernard Borios celle de dix-huit
livres et ledit Pierre Biau celle de deux
livres, et ayant calculé les susdites sommes, elles se trouvent revenir à celle de onze cents livres. Et ont tous les
susdits assemblés nommé pour recevoir
lesdites sommes ledit Raymond Senchet consul du
présent lieu et ledit Guillaume Teisseyre auxquels tous les susdits promettent et
s’obligent à la première réquisition qui leur
sera faite remettre la somme qu’ils ont ci-dessus chacun volontairement
promise. Et ont donné tous les
susdits assemblés pouvoir auxdits Senchet et Teisseyre de passer le bail à construire ladite nouvelle nef et clocher
à Jacques Carrière
et Louis Belaygue ou à tels autres qui feront la condition
meilleure en les soumettant aux mêmes charges, clauses et conditions auxquelles seront soumis les entrepreneurs dudit
chœur et sacristie, et en se conformant lesdits Senchet
et Teisseyre au devis
qui leur a été remis pour être inséré, et rapporté
dans le bail qu’ils
passeront auxdits entrepreneurs, lequel devis a été paraphé ne varietur
par moi notaire soussigné, et ont
lesdits assemblés
chargé par exprès lesdits Senchet et Teisseyre de se réserver que l’ouvrage sera sujet à vérification, réception et garantie d’un an et jour par lesdits entrepreneurs qui seront solidaires et qu’ils donneront bonnes et
suffisantes cautions si besoin est et que le tiers de la somme ne sera payé qu’après la vérification de l’ouvrage, et ont
lesdits assemblés donné pouvoir
auxdits Senchet et Teisseyre
de traiter préalablement avec les consuls et communauté de Puycelsi pour la susdite
somme de quatre
cents livres et d’en faire toutes quittances valables au
collecteur si elle est imposée pour ledit ouvrage ou à ceux qui la payeront de
l’ordre et mandat desdits consuls et
communauté qui voudra bien concourir au sujet si important pour la religion, et s’adresser à qui de droit
pour obtenir les ordonnances convenables. Présents Sr. Simon Larroque de Combemaure et Sr. Joseph Bonnavenq tous les deux habitants de la ville de Puycelsi signés ds.
avec led. Guillaume Bonnavenq,
ledit Guiral, Me. Falguière curé, le Sr. Bonnavenq
bourgeois, le Sr. Senchet bourgeois, le Sr. Paquereau, led. Teisseire, led. Jean Boyer, ledit Cazottes, les autres
n’ayant su de ce requis, et nous.
»
[Signés] Bonnavenq avocat
[en] parlement
Guirail, faisant pr. mr. de Tauriac
Senchet Falguière curé Pacarau Teysseré JBonnavenq
Jean Boyé Cassotos Larroque Combemaure
GBonnavenq Larroque notaire
royal
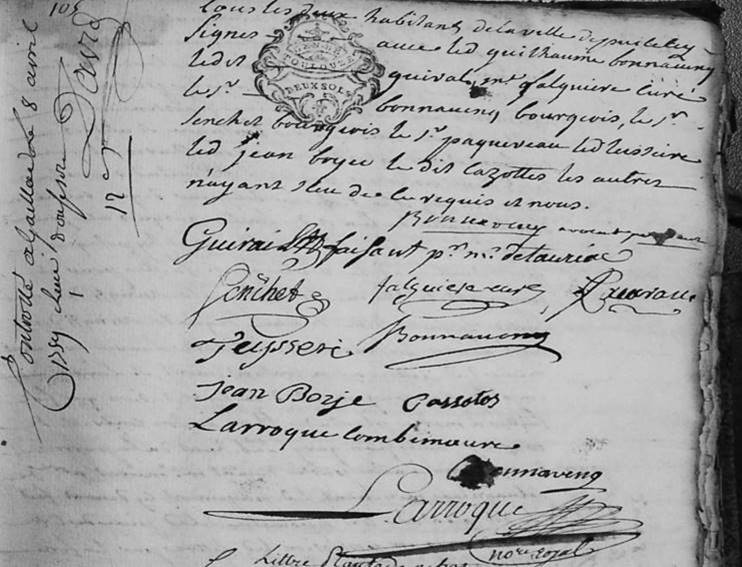
Registre cote
AD81 3E7/406, p. 105 : signatures au bas du compte rendu de l’assemblée des paroissiens de Larroque, en date du
28 mars 1759.
Appendice. Les contributeurs et leurs contributions.
|
|
Ordre alphabétique
|
livres
|
|
Contributions décroissantes
|
livres
|
|
1
|
Arman
(Jean Danne)
|
12
|
|
Boyer
de Tauriac (de)
|
300
|
|
2
|
Arman (Jean
Jantou)
|
20
|
|
Falguière
(Guillaume)
|
150
|
|
3
|
Bazanès (Jean)
|
12
|
|
Senchet (Jean)
|
65
|
|
4
|
Biau (Pierre)
|
2
|
|
Bonnavenq (Jean)
|
55
|
|
5
|
Bonnavenq (Jean)
|
55
|
|
Teisseyre (Guillaume)
|
36
|
|
6
|
Bonnencontre (Jean)
|
10
|
|
Calmels (Pierre)
|
36
|
|
7
|
Bonnencontre
(Pierre)
|
10
|
|
Senchet (Raymond)
|
30
|
|
8
|
Borios (Bernard)
|
18
|
|
Cazottes (Bernard)
|
30
|
|
9
|
Boyer
(Jean) et neveux
|
24
|
|
Carrié (Antoine Taujou)
|
30
|
|
10
|
Boyer
de Tauriac (de)
|
300
|
|
Senchet (Joseph)
|
24
|
|
11
|
Calmels (Pierre)
|
36
|
|
Carrat (Jean)
|
24
|
|
12
|
Carrat (Jean)
|
24
|
|
Boyer
(Jean) et neveux
|
24
|
|
13
|
Carrié (Antoine Mazoque)
|
3
|
|
Arman (Jean
Jantou)
|
20
|
|
14
|
Carrié (Antoine Taujou)
|
30
|
|
Teisseyre (Jean)
|
18
|
|
15
|
Cazottes (Bernard)
|
30
|
|
Borios (Bernard)
|
18
|
|
16
|
Cazottes (Jean d’Antoine)
|
15
|
|
Rech (Jean)
|
15
|
|
17
|
Cazottes (Jean jeune)
|
15
|
|
Paquereau (Bernard)
|
15
|
|
18
|
Cazottes (Jean Laroche)
|
10
|
|
Gay
(Pierre)
|
15
|
|
19
|
Charrat
(Antoine)
|
3
|
|
Gardes (Jacques)
|
15
|
|
20
|
Druilhe (Jean)
|
12
|
|
Cazottes (Jean jeune)
|
15
|
|
21
|
Falguière
(Guillaume)
|
150
|
|
Cazottes (Jean d’Antoine)
|
15
|
|
22
|
Gardes (Jacques)
|
15
|
|
Gasc (Antoine)
|
13
|
|
23
|
Gasc (Antoine)
|
13
|
|
Rech (Pierre)
|
12
|
|
24
|
Gay
(Jean)
|
10
|
|
Druilhe (Jean)
|
12
|
|
25
|
Gay
(Pierre)
|
15
|
|
Bazanès (Jean)
|
12
|
|
26
|
Mary (Paul)
|
3
|
|
Arman
(Jean Danne)
|
12
|
|
27
|
Négrier (Bernard)
|
9
|
|
Rech
et Loubet
|
10
|
|
28
|
Paquereau (Bernard)
|
15
|
|
Rech
(Bernard)
|
10
|
|
29
|
Rech
(Bernard)
|
10
|
|
Gay
(Jean)
|
10
|
|
30
|
Rech (Jean)
|
15
|
|
Cazottes (Jean Laroche)
|
10
|
|
31
|
Rech (Pierre)
|
12
|
|
Bonnencontre (Jean)
|
10
|
|
32
|
Rech
et Loubet
|
10
|
|
Bonnencontre
(Pierre)
|
10
|
|
33
|
Rossignol (Jean)
|
3
|
|
Négrier (Bernard)
|
9
|
|
34
|
Roux
(Philippe)
|
3
|
|
Suech (Marie)
|
3
|
|
35
|
Senchet (Jean)
|
65
|
|
Roux
(Philippe)
|
3
|
|
37
|
Senchet (Joseph)
|
24
|
|
Mary (Paul)
|
3
|
|
36
|
Senchet (Raymond)
|
30
|
|
Rossignol (Jean)
|
3
|
|
38
|
Suech (Marie)
|
3
|
|
Charrat
(Antoine)
|
3
|
|
39
|
Teisseyre (Guillaume)
|
36
|
|
Carrié (Antoine Mazoque)
|
3
|
|
40
|
Teisseyre (Jean)
|
18
|
|
Biau (Pierre)
|
2
|
|
|
TOTAL
|
1100
|
|
TOTAL
|
1100
|
N.B. Ce tableau compte 40 lignes, mais la ligne 32, colonne de gauche, réunit 2 noms : il y eut donc en tout 41 contributeurs, sans compter leurs
épouses, familles, etc.
2.2.
Traité passé le 19 juin 1759 entre les
représentants des habitants de Larroque et les entrepreneurs de Puycelsi pour la reconstruction de l’église paroissiale de Larroque.
Source : Archives départementales
du Tarn, Minutes de Me Antoine Joseph Larroque, notaire à Puycelsi,
cote 3E7/406, pp. 170-179. Comme le précédent, ce texte a été divisé en alinéas
et l’orthographe normalisée.
« L’an mil sept
cent cinquante-neuf et le dix-neuvième jour du mois de juin après
midi dans la ville de Puycelsi en Albigeois sénéchaussée de Toulouse pardevant nous notaire royal soussigné et présents les témoins bas nommés
furent présents Raymond Senchet consul moderne du
lieu de Larroque et Guillaume Teisseyre forgeron et aussi habitant de Larroque, lesquels
en suivant les pouvoirs à eux donnés
par la délibération prise le vingt-huit mars dernier et par nous retenue ont baillé et baillent la nef dudit lieu
de Larroque avec le clocher lesquelles constructions consistent en ce qui sera expliqué ci-après
à Jacques Carrière
et autre Jacques
Carrière oncle et neveu
et Louis et Jean Belaygue père et fils tous les
quatre maçons habitants dudit Puycelsi ici
présents et acceptants sous la clause
solidaire et indivise
de l’un pour l’autre et un d’eux en seul pour
le tout sans division ni discussion à quoi et au bénéfice d’ordre ont per
capita renoncé, laquelle dite
construction qu’ils s’obligent de faire consiste :
« En premier
lieu ladite nef sera placée sur le local qui sera assigné auxdits entrepreneurs attenant
le village dudit Larroque la porte d’entrée
regardera le couchant
et ladite nef sera bâtie en
bonne pierre chaux et sable sur le plan qui en a été dressé et dont les
entrepreneurs ont pris connaissance.
Ladite nef aura sept cannes trois pans de longueur5 et trois cannes
un pouce de largeur dans œuvre à compter depuis la porte d’entrée jusques au[x] piliers qui doivent supporter
l’arceau qui formera
le chœur qui doit être construit aux dépens des gros décimateurs suivant le bail qui a été passé devant maître Bousquet notaire
de Villemur le troisième janvier dernier.
La hauteur totale de ladite nef sera de vingt-quatre pans savoir depuis le sol
ou carrellement
jusque sous les grandes poutres du plafond vingt-deux pans et depuis le dessous desdites poutres jusques au toit deux
pans. Ladite nef recevra le jour par deux ouvertures ou fenêtres qui seront placées du côté du midi et qui seront faites
dans le goût qui sera détaillé ci- après.
« Les fondations seront
creusées jusqu’au terrain
ferme ou au rocher s’il y en a et l’on observera que ce solide ne soit pas des rochers mouvant
enfouis dans la terre qui aurait croulé de la
montagne, à la charge par les entrepreneurs de ne point poser la
première pierre desdites fondations
qu’elles n’aient été préalablement examinées par Mr Me de
Roqueplane prêtre et
archiprêtre de Lacapelle et par Me
Guillaume Bonnavenq avocat en parlement. Tous les
murs de fondation de ladite nef
seront faits en bonne maçonnerie de pierre chaux et sable ils auront quatre pans d’épaisseur et sur la
profondeur relative aux fondations ils seront montés en talus jusques à fleur du carrellement
de la nef. Les murs d’enceinte seront en bonne maçonnerie chaux et sable et auront depuis le sol ou carrellement jusques au toit trois pans d’épaisseur toutes les encoignures coins ou angles
desdits murs seront faits en pierre de taille piquée et ensernillée (?) avec la pointe du
marteau et ciseau par assises égales apparemment vues (?) et pour la solidité
des dits murs il sera placé plusieurs grosses pierres qui les traverseront. la porte d’entrée sera montée à plomb de dix pans
de hauteur et formée par deux piliers collatéraux en pierre de taille sur la largeur de huit pans et ensuite formée
en plein cintre. Les souches des piliers
c’est-à-dire les deux premières pierres de taille de la base auront dix-huit
pouces de hauteur sur une même largeur
et seront saillantes d’un pouce il sera également
placé à la hauteur
5 À Puycelsi, il semble qu’on ait utilisé de préférence
la canne de Toulouse, qui valait 1,796 m et se divisait
en 5 pieds et 6 pouces, ou en 8 pans de 22,45 cm (voir Le Pottier, 1992, pp. 71-83).
de chaque pilier
une pierre de taille de neuf pouces de hauteur et saillante d’un pouce pour former le chapiteau du pilier sur laquelle
pierre prendra sa naissance le cintre de ladite porte. Au milieu de ce cintre il sera posé une pierre de taille servant
de clef qui aura la largeur convenable pour pouvoir y placer et fouiller les armes du seigneur dudit Larroque et sera ladite
pierre également saillante
d’un pouce.
« Les fenêtres
ou croisées qui donneront le jour à ladite nef seront en carré long et auront
deux pieds de largeur et quatre
pieds de hauteur huit pouces d’embrasure en dehors des murs six pouces de
tableau et bien embrassées en dedans et cintrées en dedans.
« Il sera
permis auxdits entrepreneurs de se servir autant que faire se pourra des
matériaux de la vieille
nef en observant de faire des bons et solides
murs et à la charge par lesdits
entrepreneurs de ne démolir la vieille nef que jusques à la hauteur de
la muraille restant au cimetière qui doit
rester à tenant l’ancienne église. Il sera fait un plafond à plat en forme de planche à ladite nef en bois de peuplier
les planches à languette et à double jointure avec les clous nécessaires pour les assujettir sur les poutres qui auront
la même grosseur de celles de la vieille nef qu’on
ne pourra employer qu’autant qu’elles seront bonnes et de service et la
vieille charpente ne pourra être employée qu’autant qu’elle sera aussi bonne et de service. Les solives et chevrons seront espacés de deux pans en
deux pans et bien lattés pour recevoir la tuile canal de la couverture du toit auquel on donnera une pente
convenable et de quinze lignes au moins de chaque
côté le toit dit
sera saillant d’un pied – de chaque
côté et ce pied – ainsi saillant
pour éviter que les eaux
pluviales ne filtrent sur les fondements sera fait en deux assises de pierres égales
solidement jointes et
arrangées.
« La porte
d’entrée sera faite de bois de chêne forte et solide à deux battants et il y
sera passé ensuite une couleur brune
ou rouge le cintre de ladite porte demeurera fixe ne s’ouvrira pas mais seulement les deux battants. Il sera
fait pour les deux ouvertures ou fenêtres deux châssis ou dormants à verres ouvrants et fermants en bois de chêne
bien sec. Le ferrant de la grande porte d’entrée
sera faite avec gros
gonds, pentures, bonnes serrures et clef et un loquet proportionné à la grandeur de la porte. Il
sera placé à chacune des fenêtres de ladite nef et en dehors quatre barres de fer deux en long et deux en travers
enlacées les unes dans les autres elles
seront de la même longueur et largeur desdites fenêtres et auront un gros pouce
de large et trois quarts de pouce d’épaisseur. Elles seront scellées
solidement dans l’embrasure desdites fenêtres et placées
en montant le mur il y sera placé en dehors et à demeure un jacis
(?) de fil d’aréchal
(?) et les jacis à verre du dedans serons garnis de
leurs ferrures [serrures ?] barrettes et
de toutes leurs dépendances. La couverture du toit de ladite nef sera faite à
deux pentes en bonne tuile canal le
premier rang d’en bas et ceux d’en haut seront scellés avec bon mortier à chaux et sable chaque tuile se couvrant
l’une sur l’autre de quatre pouces au moins. Ladite nouvelle nef sera pavée et carrelée avec de bonne tuile bien
cuite et du grand moule avec bon mortier sans qu’il y soit
employé aucune vieille brique de l’ancienne nef. On pourra seulement conserver la grande pierre du tombeau de feu M. Guérin6.
« Le clocher de ladite église
sera construit du côté du couchant sur la porte d’entrée et en dedans
de ladite nef il sera fait en carré, aura dix pans dans œuvre, il sera
élevé de treize pans en mur de maçonnerie au-dessus du milieu
du couvert de ladite nef et il sera laissé un petit
avancement au mur dudit
clocher qui toucheront au toit de ladite
nef pour éviter la chute des eaux pluviales dans ladite nef le couvert
du clocher sera élevé de douze pans il sera supporté par deux arceaux
en plein cintre
un desquels arceaux
formera la porte d’entrée comme elle est expliquée plus
6 Sans doute François
Guérin : cf. la
prosopographie ci-après.
haut et l’autre sera jeté dans ladite nef. Le fondement de l’arceau jeté en dedans
de ladite nef et le fondement dudit clocher seront faits
de la même manière que les murs d’enceinte seront montés en talus et auront la même épaisseur des fondations de la
nef. La maçonnerie de cet arceau sera
faite en bonne pierre piquée à la pointe du marteau et ciseau et les
encoignures des piliers en pierre
de taille par assises égales. Il sera fait un plancher audit clocher entre la
porte d’entrée et ledit arceau
qui doit être jeté dans la nef sur toute la largeur dudit
clocher et dans ce premier plancher il sera construit une
échelle solidement établie en bois de chêne pour monter à un second plancher où l’on établira la charpente nécessaire
pour suspendre les cloches. Sur ledit
premier plancher où le carillonneur montera il y sera fait un jour ou fenêtre
qui aura trois pans de largeur et la
hauteur convenable audit clocher il y aura quatre ouvertures une à chaque aspect et auront sept pans de hauteur et
trois pans de large cintrées faites avec bonne pierre piquée à la pointe du marteau.
Il sera fait un couvert
audit clocher qui sera élevé
de douze pans au
milieu le tout en bois de chêne neuf les quatre grues ou pièces de bois qui
formeront le chapiteau de ce clocher
aboutiront à une clef pendante avec les chevrons. L’assemblage sera chevillé avec bonnes chevilles de fer
barbées. La clef du milieu du toit à laquelle aboutiront tous les chevrons
sera faite à losange et à l’extrémité dudit couvert on placera la même girouette qui est au vieux clocher ou une croix. Les chevrons dudit
couvert seront placés à deux pans de distance
l’un de l’autre et garnis de bonne et forte latte pour recevoir les tuiles à
crochet qui seront employées à cette
couverture. Le couvert sera brisqué (?) sur les grues
et ledit couvert aura une saillie
d’un pied hors du mur afin que les eaux pluviales ne tombent pas sur les murs dudit clocher.
« Il sera construit deux portes l’une du côté droit de l’arceau qui sera jeté en dedans
de la nef et l’autre
du côté gauche dudit arceau
l’une desquelles sera la porte pour monter
au clocher auquel
on montera par un escalier
qui sera adossé
au mur de la nef et sera fait en pierre de maçonnerie, et pour éclairer cet escalier il y sera
fait un jour ou fenêtre qui aura un pied de large et un pied et demi de haut ledit jour sera placé du
côté qui paraîtra le plus convenable. Il sera placé une barre de fer d’un gros pouce de large et trois quarts de pouce
d’épaisseur à ladite fenêtre et il y sera fait une petite fenêtre de bois de chêne en dedans avec gond pentules (?) et un petit verrou.
L’autre porte sera celle des fonds baptismaux et aura de même que la
précédente huit pans de hauteur et
trois pans et demi de largeur faite en pierre de taille avec porte de bois de
peuplier en menuiserie gonds pentures
serrures clef et loquets et leurs dépendances. Lesdites deux portes
seront fermées jusqu’à la hauteur de trois pans
et demi et le restant sera mis en barreaux unis faits en forme de claire-voie et proprement travaillés et peints ensuite
proprement avec l’orpiment dans le local où seront les fonts
baptismaux il y sera fait un jour, ce jour aura deux pans de large et trois pans de haut, on placera dans sa longueur
une barre de fer d’un gros pouce
de large et trois quarts de pouce d’épaisseur. L’on y placera une
fenêtre de bois de chêne bien sec en
dehors avec gonds pentules loquets et dépendances et
en dedans l’on y placera un jacis à verre à vue vitres ferrures et barrettes
pentures gonds loquets et toutes les dépendances. Ce local où seront les fonts baptismaux sera en plafond de la
hauteur de douze pans et ce plafond sera
blanchi à la colle avec deux laits de chaux dans lesquels on incorporera un peu
de bleu pour donner audit plafond
une couleur cendrée.
Le plafond ou plancher de la nef sera mis de la même couleur
que le plancher des fonts baptismaux et solidement collé. Depuis les deux portes
du clocher et des fonts
baptismaux dont nous venons de parler jusques
au plancher de ladite nef il
y sera élevé un chœur qui aura deux pans et demi d’épaisseur et qui sera bien
ciré (?) et lié avec les murs du
clocher et avec celui de la nef. La seconde porte d’entrée dudit clocher sera placée au bout dudit escalier de pierre et
cette porte restera sans fermeture et ledit clocher se trouvant suffisamment fermé au moyen de la porte
dont nous avons parlé. Les murs d’enceinte de la nef et du clocher seront
recrépis en dehors
en entier à pierre vue et enduits
en dedans avec
bon mortier fin et ensuite blanchis aussi en dedans avec deux laits de chaux. Il sera fait un enduit
avec mortier
également fin dans tous les pourtours de l’enceinte de ladite nef et dans les pourtours
du clocher et précisément sous le toit tant de la nef que du clocher cette ciselure aura une
hauteur de quinze pouces et [sera] blanchie avec deux couches de lait détrempé
avec la colle. Le clocher sera enduit
dans le même goût dans tous ses coins et angles. Le parement restera
toujours vu et il en sera usé de même sur les angles et coins de la nef de même qu’autour de la
porte d’entrée.
« Les entrepreneurs répareront les compoix7 des cloches s’ils en
ont besoin ou s’ils
le[s] gâtent dans le transport qu’ils en feront au nouveau clocher. Il sera
fait un enduit dans tous les pourtours de l’enceinte de la nef et du chœur sur une hauteur
de quinze pouces
avec une couche
de lait de chaux afin que l’on puisse peindre à fresque les armes du
seigneur dudit lieu. Il sera fait deux eaux bénites
qui seront placés à l’arceau
qui sera jeté en dedans
de la nef un de chaque côté dudit arceau. Ces eaux bénites
seront faits proprement en queue de lampe ou de
limaçon en pierre de taille bien blanche.
« Tous lesquels
ouvrages seront sujets à vérification, réception, et garantie
par lesdits entrepreneurs pour la clause solidaire
pour un an et un jour promettant lesdits entrepreneurs d’avoir rempli les obligations ci-dessus dans un an à compter du
vingt-quatre du mois courant et
seront tenus de fournir les bois de charpente, briques, pierres chaux sable et
généralement tous les matériaux
nécessaires pour lesdits ouvrages, outils, voitures, et transports à leurs
frais et dépens, et le présent bail
est fait auxdits entrepreneurs sous ladite clause solidaire pour et moyennant le prix et somme de quinze cents
livres, savoir, que lesdits adjudicataires ne seront point tenus de payer les frais de vérification ni du présent
bail. Laquelle somme leur sera payée en trois payements égaux savoir cinq
cents livres qu’ils ont tout présentement reçue desdits Senchet et Teisseyre
à leur contentement et cinq cents livres à moitié ouvrage et les cinq cents livres
restants à la réception desdits
ouvrages, promettant lesdits
entrepreneurs de faire lesdites
constructions bien solidement dans toutes les règles de l’art.
« Et à
l’instant a esté en sa personne Pierre Calmels arçonnier dudit lieu de
Larroque lequel après avoir pris
connaissance des engagements pris par lesdits entrepreneurs par la lecture que nous lui
avons faite du présent bail de nouvelle
construction de son bon gré s’est rendu caution pour lesdits entrepreneurs et a promis de faire exécuter le
présent à peine d’en répondre à son propre
prix et nom. Et de tous dépens dommages et intérêts et pour observer ce dessus
parties chacune comme les concerne
ont soumis leurs biens aux rigueurs de justice. Fait et passé présents noble Pierre de Grenier et Joseph Bonnavenq bourgeois habitants dudit Puycelsi
signés avec lesdits Teysseyre, Jacques Carrière oncle et Jean Belaigue fils, les autres n’ayant su de ce requis. »
[Signés] Granier Bonnavenq Belaigue Teysseré Carriere Larroque
Nre Royal
7 Au sens propre,
les compoix ou compoids donnaient la listes des propriétés dans chaque consulat,
préfigurant les futurs
cadastres. Ici, il pourrait y avoir une confusion avec « contrepoids ».
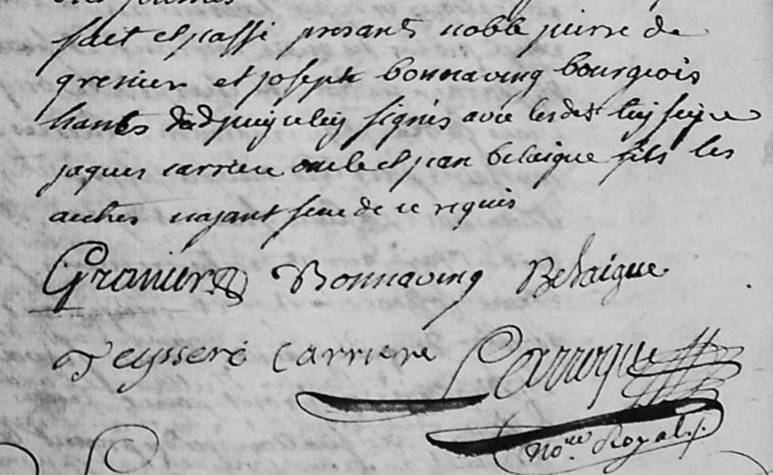
Registre cote AD81 3E7/406, p.
179 : signatures au bas du Traité du 19 juin
1759.
3. Prosopographie des personnes mentionnées dans les actes.
3.1. Les
paroissiens de Larroque
Arman, Jean « Danne
» (né vers 1725), tisserand, marié en 1756 avec Jeanne Arman, sa cousine
éloignée, sœur de Jean « Jantou » (suivant), qui est
parrain de leur fils Jean.
Arman, Jean « Jantou
» (1709-1778), fils de Jean « Jantou » et de Raymonde
Gay, tisserand, apparenté
par sa mère aux entrepreneurs ; marié en 1735 avec Françoise Roux, elle aussi parente des entrepreneurs.
Bazanès, Jean
(1703-1781), fils de Jean et Jeanne Audourenc ;
tailleur. Par sa mère, il était cousin
éloigné des Bonnavenq.
Biau, Pierre,
né en 1687, fils de Pierre (dit aussi Bernard), tailleur, un des plus âgé des
« paroissiens ». Il était parent
des Belaygue
entrepreneurs ainsi que des Teysseyre.
Bonnencontre, Jean : travailleur, fils
de Pierre travailleur de Fonblanque (paroisse de
Vaour) et Marie Deymier, cousin des entrepreneurs par sa mère.
Bonnencontre, Pierre, frère du précédent
; travailleur/charbonnier, lui aussi cousin des entrepreneurs par sa mère, mais en outre
époux de Marie Audourenc, née en 1741. Or cette dernière se trouvait être, par son père
Bernard, une parente éloignée des Bonnavenq ; et elle était en outre, par sa mère Cécile Calmels, une petite fille de Pierre Calmels
et Catherine Teysseyre,
et une nièce de Marguerite Teysseyre, ce qui faisait
d’elle une parente proche des quatre entrepreneurs.
Borios (Bories), Bernard
(né vers 1726) :
tisserand, fils de Salvy et de Marie Teysseyre (mariés
en 1723), frère de Guillaume et Dominique. Par sa mère, sœur de Jean Teysseyre, il était apparenté aux entrepreneurs.
Boyer, Jean (1692-1774) : maître
tisserand, fils de Bernard et Gabrielle Carrière, de Penne, donc apparenté aux entrepreneurs de
Puycelsi. Par ailleurs, sa sœur Anne était mariée avec Raymond Senchet, le consul de Larroque.
Calmels, Pierre
(v1698-1773), arçonnier, résidant à Larroque, avait
épousé en 1721 Catherine Teysseyre (v1700-1770), sœur de Marguerite Teysseyre, laquelle était la mère de Jacques Carrière neveu, l’un des quatre
entrepreneurs engagés pour reconstruire l’église. Marguerite Calmels, fille
cadette de Pierre et Catherine, née vers 17398, s’est mariée le 7
février 1759 à St Corneille de
Puycelsi avec Jean Belaygue, fils de Louis, deux
autres des quatre entrepreneurs. C’est
sans doute en raison de ses liens multiples avec ces derniers que Pierre Calmels s’était porté caution pour eux. Les Calmels formaient une famille nombreuse et influente, qui possédait une vingtaine de propriétés sur le consulat
de Puycelsi. Jean Calmels, fils de Pierre et Catherine, et frère de Marguerite, né vers 1732, fut élu Consul et «
Procureur de la commune de Puicelsy » le
14 février 1790, charge qu’il ne put exercer du fait de son décès le 17 avril
suivant. C’est ensuite en 1791
que la commune de Larroque fut séparée de Puycelsi.
Carrat, Jean (1718-1791), serrurier et armurier à Larroque, cousin de Guillaume Teysseyre.
Carrier, Antoine « Mazoque », tisserand (1688-1763), allié aux Teysseyre et donc aux entrepreneurs.
Carrier, Antoine « Taujou
» (1716-1789), neveu du précédent, tisserand, marié en 1742 à Jeanne
Biau, elle aussi cousine
des Belaygue.
Cazottes,
Bernard (1706-1769), fils de Pierre et Guillaumette Teissonières, filleul de Bernard Pourtié jeune, de Puycelsi ; brassier
; pas d’épouse connue.
Cazottes, Jean «
d’Antoine ». Personnage problématique : un Raymond Cazottes,
dit « Jean d’Antoine », épouse une Raymonde Trégan en 1769. Mais il était sans doute trop jeune
en 1759 pour être l’un des contributeurs. Peut-être son père ? En tout
cas, il était très certainement apparenté aux deux suivants.
Cazottes, Jean «
jeune » (ou « Jon »), dit « orphelin », brassier ou tisserand ; peut-être originaire de
St Maffre de Bruniquel, où habite son frère Pierre ; marié avec Marie Gay (sœur de Jean et Pierre, ci-dessous) et par là
beau-frère de Jean Belaygue, un des entrepreneurs.
Bien que simple artisan, il est
relativement aisé : dans son testament de 1769, il laisse 100 livres à chacun
de ses quatre fils puînés et fait héritier
universel son fils aîné.
Cazottes, Jean «
Laroche » (vers 1691-1781), tisserand. En 1726, il avait épousé Françoise Littré,
cousine germaine de Louis Belaygue, un des quatre
entrepreneurs.
Charrat, Antoine, brassier, apparenté
aux Rech (ci-dessous).
8 Son acte de naissance (ou de baptême)
n’a pas été retrouvé dans les registres disponibles. Dans son acte de mariage, elle est dite fille cadette
de Pierre.
Druilhe, Jean (né vers 1729), tailleur
d’habits. Neveu de Françoise Belaygue et par elle cousin des entrepreneurs.
Gardès, Jacques
(né vers 1715), travailleur, marié vers 1745 avec Françoise
Andrieu, de Laval
(consulat de Puycelsi), apparentée à Françoise Littré, la mère de Louis Belaygue.
Gasc, Antoine « Jibbat » (né vers 1708), laboureur, fils de Jean et Marie Moncéré (de Penne), marié vers 1736
avec Jeanne Biau (fille
d’Antoine et Françoise Cazottes).
Gay,
Jean « aîné » (né en 1706), brassier,
fils de Pierre et Françoise
Carrat, marié en 1740 avec Marie
Cazottes (fille de Pierre et
Jeanne Senchet).
Gay, Pierre (né en 1717), frère cadet du
précédent, brassier ou tisserand, époux de Catherine Calmels (fille de Pierre arçonnier et Cécile Senchet), et
par là beau-frère de Jean Belaygue, un des quatre entrepreneurs.
Guérin, François, mentionné par le
Traité car inhumé dans l’ancienne église St Nazaire (en 1746). Descendant des Guérin, notaires à Puycelsi depuis le XVIe
siècle (Bourdès, 1914), il était apparenté aux Larroque, et aussi, par sa mère Guillemette Cazottes, aux Carrat, aux
Teysseyre, aux Senchet,
etc. Il ne faut pas confondre cette famille avec les Guérin Du Cayla, qui résidaient au château de ce nom, mais
possédaient aussi une maison à Puycelsi. François Guérin avait hérité de sa mère le château de Larroque. Sa fille
Françoise Guérin, mariée à Guillaume II Bonnavenq (ci-dessous), en a hérité à son tour en 1746.
Mary, Paul : inconnu. Ce nom ne figure
ni aux BMS du consulat de Puycelsi, ni au compoix de 1690/1790. Un Paul Mary est né en 1710 à Castelnau-de-Montmiral9 : est-ce le
« paroissien » de St Nazaire
?
Négrier, Bernard (1723-1782), tisserand, appartenait à une famille présente
dans le consulat de Puycelsi
au moins depuis le début du XVe siècle (de Bourdès, 1914). Il était le fils d’Antoinette Belaygue,
lointaine cousine des entrepreneurs, et son épouse Gabrielle Druilhe était la fille de
Françoise Belaygue, parente
proche de ces derniers. Leur fils Jean Négrier, né en 1753,
sera en 1792 le premier
officier municipal de la commune
de Larroque, créée
l’année précédente. Jean sera
aussi le trisaïeul de Germaine Négrier (1882-1976), grand-mère maternelle de
l’auteur du présent travail,
née et décédée à Larroque.
Paquereau (Pacarau), Bernard,
brigadier détaché à Larroque, époux en 1741 de Françoise Arman (fille de Jean et Raymonde Gay), et par là apparenté aux entrepreneurs.
Rech,
Jacques (né en 1709), arçonnier, fils de Pierre
et Marie Biau ; associé dans le texte
à Jean Loubet, qui était son gendre.
Rech,
Bernard (né en 1706), frère
de Jacques.
Rech, Jean, frère des précédents,
tisserand, époux de Barthélémye Calmels
et ainsi allié aux Belaygue entrepreneurs.
Rech,
Pierre (né en 1737),
arçonnier, fils de Jacques et beau-frère de Jean Loubet.
9 D’après la base généalogique de Stéphane Grégoire, en ligne à l’adresse http://genetarn.free.fr/
Rossignol, Jean (né en 1716), brassier, fils de Pierre
et Catherine Brun, marié avec Magdeleine Magné.
Roux, Philippe (vers 1710-1782),
employé des gabelles (« gabelou »). Marié avec Marie Calmels et par là allié aux
entrepreneurs.
Senchet, Jean.
Troisième contributeur de la liste, il s’agit sans doute du « sieur Jean Senchet, bourgeois
de Larroque » (vers 1712-1780), inhumé à St Nazaire en présence de son frère
aîné Joseph Senchet
et de son neveu Pierre Senchet, fils de Joseph. Cité
dans le compoix de 1690/1790, mais seulement à partir de 1776,
il a
dû s’enrichir dans le négoce.
Senchet, Joseph,
ou plutôt Joseph Antoine (1704-1782), fils de Jean « Mader » et de Jeanne Belcayré, frère aîné du précédent, marié avec Jeanne
Delpon en 1735. Il est cité dans le compoix
de 1690/1790 sous le nom
d’Antoine, laboureur.
Senchet, Raymond
(vers 1700-1792), tisserand
et « ménager de son bien », consul
moderne de Puycelsi en 1759, curieusement absent du
compoix de 1690/1790. Fils de Jean et Jeanne
Teysseyre, donc par son père oncle à la mode de
Bretagne de Joseph et de Jean Senchet (ci- dessus), et par sa mère parent des
entrepreneurs. Marié en 1722 à Mespel avec Anne
Boyer, fille de Bernard et Gabrielle Carrière,
de Penne, et donc parente des entrepreneurs.
Suech, Marie,
veuve de Pierre Arman : ce couple est absent des BMS, et par ailleurs « Pierre Arman » est une combinaison très répandue
ici. Le nom de Suech est connu de Puycelsi, mais la seule Marie que cite Stéphane Grégoire8 serait née vers 1775
au hameau de Lacapelle.
Teysseyre, Jean (né vers 1702), forgeron,
fils de Dominique [Domenge] et Marguerite Andrieu,
frère de Marguerite Teysseyre, et donc oncle maternel de Jacques Carrière
« neveu » du contrat de 1759,
époux en 1728 de Cécile
Biau.
Teysseyre, Guillaume
(né en 1716), forgeron, fils de Pierre (frère de Jean ci-dessus) et Cécile Borios, parent des Carrière et des Belaygue par ses cousines
Catherine et Marguerite Teysseyre, par ailleurs époux
de Maffronne Carrier
(patronyme à ne pas confondre avec Carrière), cousine
des Belaygue. C’est lui que l’assemblée des
paroissiens avait mandaté pour rassembler leurs contributions. Sans doute Guillaume avait-il, dans le village,
une réputation de prudence et d’intégrité.
Nos critères actuels l’empêcheraient peut-être de remplir la fonction qui lui
avait été confiée. Mais sans doute
l’assemblée des paroissiens a-t-elle pensé que la parenté de Guillaume avec les entrepreneurs était un
critère supplémentaire de zèle dans la collecte des fonds et d’honnêteté à
l’égard de ses cousins.
3.2. Les entrepreneurs
L’acte du 28
mars 1759 indique : « ont donné tous les susdits assemblés pouvoir auxdits Senchet et Teisseyre de passer le bail à construire ladite nouvelle
nef et clocher à Jacques Carrière et Louis Belaygue », sans plus de détail.
Mais le traité
du 19 juin 1759 précise
« Jacques
Carrière et autre Jacques Carrière, oncle et neveu, et Louis et Jean Belaygue, père et fils,
tous les quatre maçons habitants dudit Puycelsi ». Ces deux familles, dont
plusieurs membres pratiquaient la
taille des pierres et la maçonnerie depuis des générations, à Penne- d’Albigeois et à Puycelsi, s’étaient alliées de nombreuses fois, dans ces villages où l’endogamie était importante, comme on peut le
constater dans la présente prosopographie. Le tableau ci- dessous
montre une partie de ces liens. Outre l’alliance de 1681, on voit qu’en 1758, année
précédant les actes fondateurs, un mariage avait réuni une fois de plus les deux noms : Jacques
Carrière « neveu » avait épousé Marie Belaygue, fille de « Louis Belaygue père » et sœur de
« Jean Belaygue fils ».
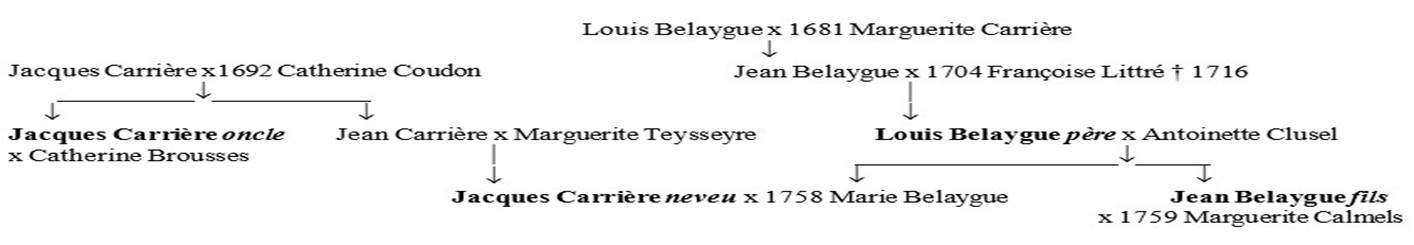
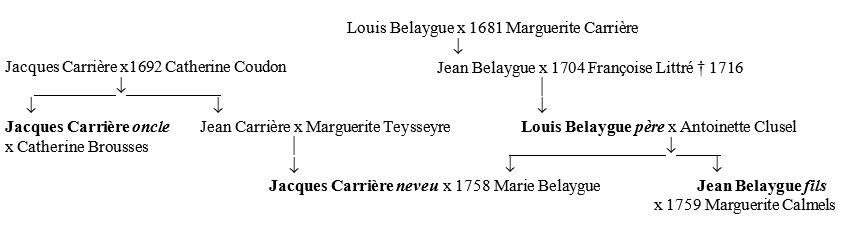
3.2.1. Les Belaygue
Belaygue Louis (1705-1771) était fils de Jean
et de Françoise Littré, mariés en 1704, et son
père était lui-même fils d’un autre Louis, marié en 1681 avec une
Marguerite Carrière, autre exemple des alliances répétées entre ces deux lignées (cf. le tableau ci-dessus). Sous l’entrée
« Louis Belaigue charpentier », et les dates 1693-1776, le compoix
de Puycelsi liste une vingtaine d’articles,
montrant que cette famille jouissait d’une honnête aisance. Louis s’est marié en 1728 à Puycelsi avec Antoinette Clusel, de Monclar-de-Quercy (actuel Tarn-et- Garonne). La base généalogique de Fabienne
Thierry (site « Généanet ») nous apprend que les parents d’Antoinette : Mathieu Clusel ou Cruzel, laboureur à Monclar, et Marie Rougé (née à Puycelsi, paroisse N.-D. de Laval),
avaient passé un contrat de mariage en décembre 1700. Elle était
leur fille unique,
Mathieu étant décédé peu après sa naissance. Marie Rougé s’est remariée en 1717 avec Jean Belaygue,
lui-même veuf de Françoise Littré. J’ignore si Antoinette a vécu avec sa mère dans la maison de son beau-père, aux côtés de son futur époux, ou si elle est restée
à Monclar, comme le contrat de mariage semble
le dire. Quoi qu’il en soit, mariés en 1728,
Antoinette et Louis eurent
six enfants, dont Marie, née en
1730, et Jean, né en 1733 :
– Marie (1730-1791), épouse
en 1758 de Jacques
Carrière entrepreneur, ci-dessous ;
– Jean « fils », né en 1733, avait reçu une certaine
instruction puisqu’il a pu signer
le Traité du 19
juin 1759, contrairement à son beau-frère Jacques Carrière « neveu ». Il
s’était marié au début de 1759, peu avant
le premier des textes repris
ici, avec Marguerite Calmels, fille cadette de Pierre, arçonnier,
et de Catherine Teysseyre (dont la sœur, Marguerite Teysseyre, était la mère
de Jacques Carrière). Ils ont eu au moins six enfants. Marguerite est décédée
en 1801 et Jean lui a
survécu jusqu’en 1813.
3.2.2. Les Carrière
Carrière Jacques « oncle » (1697-1770),
époux vers 1735 de Catherine Brousses, est connu dans les textes comme tailleur de pierres et maçon. Il était
issu d’une famille originaire de Penne-d’Albigeois, localité où la maçonnerie était
florissante. On y voit encore aujourd’hui de
superbes maisons de pierres, à la fois dans le village et dans les hameaux périphériques. Jacques et Catherine
avaient un fils, également prénommé Jacques, dont les actes ne parlent pas. Les pages du compoix de Puycelsi des années
1680-1790, très semblables à celles des Belaygue, enregistrent sous l’entrée « Jacques Carrière
maçon », une vingtaine de biens immobiliers :
chenevières, jardins, terres, vignes, etc. Jacques « oncle »
avait appris à lire et à écrire, et il a signé
au bas du Traité du 19 juin 1759.
Carrière
Jacques « neveu » (1736-1793) était fils de Jean (1695-1747), ce dernier frère aîné de Jacques
« oncle » et maçon comme lui, et de Marguerite Teysseyre,
laquelle était née à Larroque en 1709 et se trouvait être la
tante de Marguerite Calmels, épouse de Jean Belaygue. Jacques
« neveu » s’était marié en 1758 avec Marie Belaygue,
fille de Louis et d’Antoinette Clusel/Cruzel (ci-dessus). Les
deux plus jeunes entrepreneurs étaient donc étroitement alliés, Jacques neveu étant, par son mariage, le beau-frère de Jean Belaygue (cf. tableau ci-dessus).
3.3. Les
autres acteurs
Bonnavenq,
Guillaume II (1717-1794), fils de
Jean et de Magdeleine Terrène, de Rabastens, petit-fils de Guillaume I, notaire à Puycelsi de 1697 à 1732.
Guillaume II se dit « avocat en parlement », et aussi « habitant de
Puycelsi ». En fait, il résidait aussi en 1759 au château de Larroque, dont son épouse Françoise Guérin
(1726-1782) avait hérité en 1746. Ils étaient les plus riches habitants
de la région, la liste de leurs propriétés occupant
12 pages dans le compoix
de Puycelsi des années
1680-1790. Après 1764, le marquis
de Tauriac (ci-dessous) leur vendra tous ses biens situés sur le consulat de
Puycelsi. Leur fille Marie Françoise Bonnavenq (1757- 1839)
épousera en 1777 Nicolas François Louis de Tholozany de La Sesquière (1750-1822), et les descendants de ce couple résideront au château de Larroque jusqu’en 1991.
Bonnavenq, Jean,
« bourgeois de Puycelsi », était soit le père du précédent (1695-1768), soit son oncle Jean Pierre (né en
1702).
Bonnavenq,
Joseph, « bourgeois de Puycelsi », était probablement le plus jeune frère de Guillaume, né en 1738.
Boyer, Louis Joseph Eugène de
(1722-1803), « marquis de Tauriac », résidait au château de Saint-Urcisse chez son père François de Boyer (1674-1764), toujours vivant en 175910. François possédait aussi le château de
Tauriac, ainsi que la « maison forte » de La Coste, au lieu-dit du même nom sive de Mailhac,
sur la paroisse St Martin d’Urbens (actuelle commune de Larroque), dans le consulat de Puycelsi
; il était le fils aîné de Salvy de Boyer
(1632-1716), maire perpétuel de
Puycelsi entre 1694 et 1715, et d’Anne de Castanet de Tauriac, fille du dernier
baron de ce nom en ligne masculine. Celui-ci avait voulu que son titre passe au fils aîné d’Anne,
donc à François, père de Louis Joseph
Eugène. En 1759, ce dernier
s’intitulait marquis de Tauriac, titre doublement ou triplement « de courtoisie », puisque son père François, héritier d’un titre
de baron par une voie féminine contestable (et du reste contestée), vivait
encore. Ce même François
de Boyer était
aussi seigneur de Larroque par héritage de son propre
père Salvy à qui cette seigneurie avait été cédée le 25 mai 1714.11 Absent des délibérations, le marquis s’y était
fait représenter par Géraud Guiral, procureur
juridictionnel habitant de Saint-Urcisse. Il
fut le principal contributeur des paroissiens, avec un don de 300 livres. En échange, il demanda que ses armoiries soient sculptées à l’extérieur et peintes à l’intérieur de la future église.
10 Né au château de La Coste le 12 juillet 1674, baptisé à St Martin
d’Urbens le 17 sous le seul prénom
de François (le prénom Antoine,
d’abord écrit sur l’acte de baptême, ayant été rayé) ; nommé Jean François
et dit âgé d’environ 80 ans dans son acte de décès du 14
février 1764, qui figure aux registres BMS de la paroisse St Urcisse, actuelle commune
de Saint-Urcisse, Tarn (tous ces registres sont consultables en ligne sur le
site internet des Archives départementales du Tarn). Sur la famille
de Boyer et ses alliances, cf. Du Guerny,
2006.
11 Rossignol, 1865, pp. 396-397, 409-410 ; Du Guerny, op. cit.
Falguière, Guillaume (v1720-après
1792), curé de Puycelsi, fils de Guillaume, lieutenant principal en la judicature d’Albigeois au siège de Rabastens et contrôleur général
au bureau des finances
en la généralité de Toulouse, et de Raymonde Satgé12. On a conservé quelques sermons prêchés par lui en langue d’oc
afin de se faire mieux entendre de ses paroissiens, qui, pour la plupart, connaissaient peu ou pas du tout le français.
Des mentions de sa main figurent aux BMS de St Corneille jusqu’en
1792, dernière année
de ces registres. Il offrit
150 livres pour l’église
de Larroque, annexe de la sienne, deuxième contribution par ordre d’importance
après celle du marquis, ce qui montre - outre sa générosité - l’écart
important qui existait,
vers la fin de l’ancien
régime, entre les conditions économiques des
curés et celles de leurs ouailles.
Grenier (Pierre de) signe « Granier » : il s’agit peut-être de Grenier de Lartigue,
présent au baptême de François Joseph
Larroque le 12 septembre 1734 et au baptême de Simon Joseph Larroque le 29 mars 1737. Les Granier ou Grenier, divisés en de nombreuses branches, formaient
une grande famille
de gentilshommes verriers
qui exerçaient leur art dans tout le sud- ouest de
la France.
Larroque, Antoine Joseph, notaire
à Puycelsi de 1755 à 1800, a enregistré les deux actes objets de la présente note. Il a sans doute
rédigé le second avec l’aide et sur les indications des entrepreneurs eux-mêmes. La famille Larroque, dont le nom est le
même que celui du village, est connue
à Puycelsi depuis
le XVe siècle
(Bourdès, 1914). Elle s’est alliée
aux nobles locaux,
dont la plupart
étaient des verriers
(Audouin, Grenier, Robert,
Suère…), et aux autres notables,
tels les Bonnavenq et les Guérin. Enrichies
par le notariat et le négoce, certaines branches résolurent de se singulariser en rajoutant un nom de terre à leur patronyme, comme les Combemaure.
Larroque (de Combemaure), Simon, parent du
précédent, témoin de l’assemblée du 28 mars
1759.
Roqueplane (de), archiprêtre et curé de Lacapelle (paroisse de Puycelsi), chargé par le Traité d’examiner les fondations de l’église.
4. Conclusion
L’église St Nazaire de 1759 se dresse encore aujourd’hui au centre du village de Larroque, sans doute
peu différente de ce qu’elle était lors de sa construction. Des modifications
mineures lui ont été apportées aux
XIXe et XXe siècle, mais je n’en connais pas le détail ;
elle a subi aussi diverses réfections
et ravalements. Ce qu’en dit Rossignol est très succinct : « l’église de Larroque est construite à neuf, dans le
style roman, et à trois nefs.13 »
Quoi qu’il en soit, dans l’état
où elle nous est parvenue, elle témoigne avec élégance et discrétion du
savoir-faire des tailleurs de pierres
et maçons qui exerçaient leur art dans les campagnes de l’Albigeois, au XVIIIe siècle. Elle rappelle
aussi le zèle et la générosité des habitants de Larroque, qui avaient accepté
de contribuer à sa construction. Dans un registre
plus personnel, l’auteur
de la présente contribution
a presque tous les personnages de cette histoire comme ascendants directs ou collatéraux : il souhaite que ce travail
soit un modeste hommage à leur mémoire.
12 D’après Stéphane Grégoire.
13 Rossignol, 1865, p. 410.
5. Bibliographie
Bourdès (Albert de). Documents épars. Toulousain, Bas-Albigeois, Bas-Quercy et Pays voisins. Deuxième Série. Puycelsi, Castelnau
de Montmirail, Cordes,
Gaillac, Rabastens, Penne,
Bruniquel, Montricoux, Montclar, Montech,
Montauban, Toulouse et environs. Albi,
Imprimerie des Orphelins-Apprentis, 1914, iv+754 p.,
tableaux dépl., pl. dépl.
Choiseul (Léopold-Charles de). Statuts synodaux du diocèse d’Alby,
publiés au Synode
tenu au mois d’avril de l’année M.DCC.LXII. Albi, J.B. Baurens, 1763, ii+248 p., tableau dépl.
Du Guerny
(Yannick). Archives des châteaux de Saint-Urcisse & de Tauriac
(Tarn). Inventaire. Languedoc, Quercy, Rouergue, Champagne, Saintonge.
2006. En ligne sur le site https://fr.
geneawiki.com/index.php?title=Archives_priv%C3%A9es_-_Fonds_Chassin_Du_Guerny
#In ventaires _de_fonds
Le Pottier (Jean),
directeur. Communes du Tarn. Dictionnaire
de géographie administrative, paroisses, étymologie, blasons, bibliographie. Conseil Général du Tarn, Archives départementales, collection « Archives &
Patrimoine », 1990, lxiv + 630 p., illustr.
Le Pottier (Jean),
directeur. Compoix et cadastres du Tarn
(XIVe-XIXe), étude et catalogue, accompagnés d’un tableau
des anciennes mesures
agraires. Conseil Général
du Tarn, Archives
départementales, collection «
Archives & Patrimoine », 1992,
258 p., illustr.
Rossignol (Élie-Antoine). Monographies communales. Étude statistique, historique et monumentale du
département du Tarn. Arrondissement de Gaillac. Tome III. Cantons de Cordes, de Vaour et de
Castelnau-de-Montmiral. Toulouse, Delboy ; Paris,
E. Dentu ; Albi, Chaillol, 1865, 458 p., cartes, planches.
Tranier (Auguste). Dictionnaire historique et géographique du département
du Tarn. Albi, Ph. Tranier fils, 1862, LXVIII + 342 p., carte coloriée.
Remerciements. Ils vont surtout
à Stéphane Grégoire,
qui non seulement a fourni les photographies des actes présentés
ici, mais dont le site internet à l’adresse http:// genetarn.free.fr/ est une base de travail désormais
indispensable pour toute recherche généalogique dans le nord du Tarn. Ma gratitude va en outre aux Archives
Départementales du Tarn (AD81), qui ont mis en ligne sur
leur site les registres paroissiaux et d’état-civil des communes, ainsi que les compoix. En outre, certains registres
notariés ont été mis en ligne d’après
des clichés pris soit par les AD81, soit par des généalogistes amateurs,
notamment Stéphane Grégoire. Les deux
actes publiés ici font partie d’un de ces registres mis en ligne, mais M.
Grégoire me les avait communiqués antérieurement.
———————————————
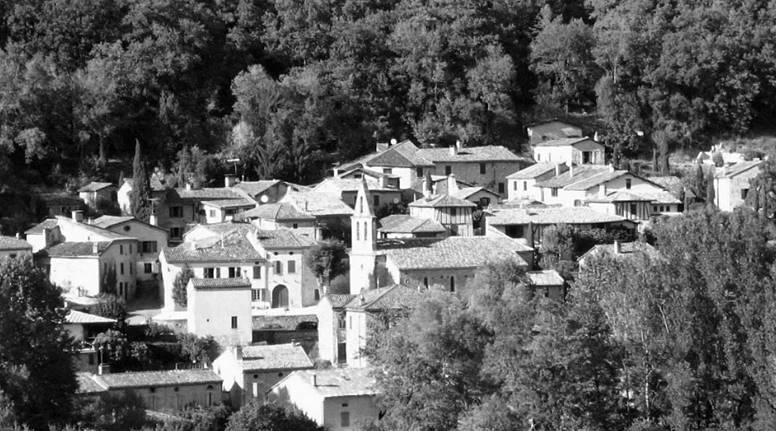
![]()